-

-
Églises du
-
haut
- .
-
Cancon
- .
-
Castillonnes
- .
-
Monflanquin
- .
-
Villeréal
- .
- .
-
Calvaires
-
Portails
-
Peintures
-
Sculptures
-
Retables
-
Vitraux
- .
- .
-
Glossaire et web
-
Glossaire Clergé
-
diocèse : histoire
- .
- .
-
églises ailleurs
-
hagiotoponymie
-
-
-
Recherche d'une vue aérienne d'un lieu
-
sur "google earth"
-
-
-
- *************
-
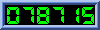
-
-
.
| |
LES ÉGLISES ET LES PAROISSES
RURALES
DU
HAUT MOYEN ÂGE
- L’époque du haut Moyen Âge marque la pénétration et
l’organisation de l’Église dans les campagnes d’Occident.
-
- .
-
- C’est à cette période que l’on voit s’implanter les églises
et se constituer ces " circonscriptions " que sont
les paroisses* rurales : la " paroisse " qui
ne prend son sens définitif qu’au vie siècle, alors que
la " parochia " désignait auparavant le
diocèse (au sens de " habitat momentané " par
rapport au ciel, patrie éternelle).
-
- Phénomène fondamental dans le développement religieux des
royaumes barbares et dont, pourtant, les contemporains parlent peu ;
les sources se limitent donc à quelques décisions de conciles, à
quelques allusions dans les écrits d’évêques et aux recherches
toponymiques et archéologiques qui permettent d’éclairer la
complexité du problème.
-
- Mise en place du réseau paroissial et organisation rurale de la vie
religieuse seront deux axes de réflexion.
-
- Pour trouver des illustrations spécifiques à tous ces sujets voir :
- www.berinsteinresearch.com
un site américain très performant.
-
- I. L’IMPLANTATION DES ÉGLISES ET DES
PAROISSES RURALES
-
- Au moment où nous l’abordons, l’Église a dû s’adapter au
nouveau cadre des monarchies barbares : à l’Église de l’Empire
ont succédé des Églises " nationales " qui
s’organisent dans le cadre de chaque royaume, prenant chacune un
caractère original.
-
- L’organisation ecclésiastique des campagnes illustre ce
particularisme religieux : le développement des églises et des
paroisses rurales ne s’y est fait ni au même moment ni de la même
façon.
-
- La christianisation des campagnes n’a d’abord concerné que
les régions les plus profondément romanisées, c’est-à-dire
l’Italie et la Gaule méridionale (dès la fin du IVe siècle),
puis l’Espagne. Exception faite de l’Irlande précocement
christianisée (dès la fin du Ve siècle), bien que non
romanisée. Quant aux autres régions, comme la Gaule du Nord, l’Angleterre,
la Germanie, elles n’ont vu s’implanter des églises dans leur
campagne que lentement et tardivement.
-
- D’autre part, le mode d’implantation a varié selon les pays et
selon les époques : les églises rurales ont pu être soit l’œuvre
d’un évêque (selon le mode romain et dans les régions romanisées),
soit celle d’un seigneur, ou bien encore celle d’un monastère
(selon le mode celtique).
-
- Organisations différentes, dont est issu le développement inégal
du système paroissial.
-
- A. L’héritage
gallo-romain
-
- Églises et paroisses rurales en Gaule
-
- Jusqu’au ve siècle, les églises sont surtout urbaines
et épiscopales.
- C’est-à-dire qu’elles se sont d’abord implantées là où la
romanisation était la plus forte : dans les villes.
-
- En outre, les responsables du clergé tiennent à contrôler et
centraliser les fidèles autour de l’église du diocèse : ils
sont donc longtemps réticents à multiplier les lieux de culte.
-
- Cependant, les besoins accrus des fidèles obligent les autorités
à implanter des églises dans les campagnes, dès la fin du IVe
siècle. Ainsi :
-
- – d’une part les évêques vont créer des églises dans les
" vici " : sortes de succursales de
l’église du diocèse qui gagnent au début du Ve siècle
le rang d’églises baptismales ;
-
- – d’autre part, ils tolèrent la construction d’édifices
cultuels dans les " villae " des grands
propriétaires, mais qui restent sous la dépendance des églises de
" vici ".
-
- B. Les églises et les
paroisses mérovingiennes
-
- L’implantation des paroisses mérovingiennes ne s’est pas faite
de façon uniforme sur l’ensemble de la Gaule : il semble
qu’il y ait eu deux Gaules, chacune correspondant à deux vagues de
missions.
-
- – Une " Gaule conciliaire " qui a hérité
des structures ecclésiastiques romaines et où l’œuvre de
christianisation des campagnes est menée par les évêques. Il
s’agit des régions les plus romanisées, c’est-à-dire
principalement de la Gaule méridionale.
-
- – Une " Gaule monastique "
où le mouvement de christianisation des campagnes a été plus
tardif, mené surtout par les missions de moines à partir de la deuxième
moitié du viie siècle et qui concerne le Nord de la Gaule
(entre Seine et Meuse environ).
-
- Remarque : la limite entre les deux Gaules est difficile à définir.
-
- L’organisation des paroisses dans la " Gaule
conciliaire "
-
- Les paroisses sont organisées sur le modèle gallo-romain que
nous venons d’analyser, c’est-à-dire qu’elles comportent à
la fois des " ecclesiae " (églises de vici)
et des " oratoria " (sanctuaires privés)
distinction ainsi présentée par Grégoire de Tours dans son Historia
Francorum (X, 31)
-
- Conclusion sur les premières églises :Ces
premières églises ont été non pas destinées à encadrer les
ruraux mais bien plutôt à les atteindre pour les christianiser.
Parties des villes, elles vont essaimer lentement à travers la
campagne, œuvres d’un évêque, d’un seigneur ou d’un
monastère.
-
- II. ORGANISATION ET VIE PAROISSIALE
-
- La paroisse du haut Moyen Âge est une entité territoriale et démographique
strictement délimitée. Desservants et fidèles se retrouvent dans
les édifices paroissiaux qui par leur regroupement constituent un
ensemble architectural facilement repérable dans le paysage.
-
- A. Les édifices paroissiaux
-
- 1. L’église
-
- L’archéologie et la documentation écrite donnent peu de
renseignements sur cet édifice.
-
- Le bâtiment était semble-t-il exigu et certainement vulnérable
en raison de la modestie de la construction et du matériau employé,
le bois. Sans doute se délabrait-il rapidement et les conciles
recommandent maintes fois leur bon entretien.
- Surtout, la législation, tant civile que religieuse, rappelle que
l’église et l’autel doivent avoir été consacrés par l’évêque
avant que le prêtre y célèbre la messe. On trouve peu
d’ornements, pas de statues mais quelques peintures et vases, et surtout,
symbole de la prière constante, une " lumière ",
entretenue par des ciriers, qui doit brûler en permanence.
2. Le cimetière
- À partir du VIIIe siècle, tout fidèle doit être
enterré au cimetière situé autour de l’église. Les tombes
s’y pressent, sans ordre, et le plus près possible de l’édifice.
- Attenante à l’église et au cimetière se trouve la maison du prêtre.
-
- 3. La maison du prêtre
-
- Il doit impérativement l’habiter.
-
- Avec la généralisation de la levée de la dîme, elle doit être
flanquée d’une grange pour stocker les récoltes.
-
- Une parcelle de terre l’entoure, c’est l’ancêtre du jardin du
curé actuel.
-
- B. Les desservants
Voir le document: La formation des clercs. (789).-
- Le haut Moyen Âge a connu deux générations différentes de prêtres
ruraux définies par leur mode de nomination.
-
- 1. La nomination des prêtres
-
- – Jusqu’au VIIIe siècle, le prêtre de la grande
paroisse baptismale* est choisi et ordonné par l’évêque,
d’où son étroite dépendance à l’égard de son supérieur hiérarchique.
L’évêque par souci de contrôle et d’encadrement procède à des
visites pastorales et réunit les clercs lors du synode annuel.
-
- Cependant, sur ce vaste territoire, de riches propriétaires ont
construit des édifices cultuels privés : le clergé de ces
oratoires ou chapelles peut y célébrer la messe sauf à l’occasion
des six plus grandes fêtes religieuses (Noël, Pâques, Pentecôte,
…) pour lesquelles prêtres et fidèles doivent se retrouver à l’église
paroissiale.
-
- À la fin du VIIIe siècle, l’évêque n’a pu
conserver que son pouvoir spirituel sur le prêtre, son contrôle économique
et social est désormais entre les mains du fondateur propriétaire de
l’église
2. Le mode de vie clérical
- – Le prêtre se distingue des fidèles par son aspect extérieur.
Il porte la tunique longue, la casula, future chasuble*. Sa
barbe doit être rasée et ses cheveux coupés court.
-
- Le célibat auquel les clercs sont astreints ne semble pas être
autre chose qu’un principe souvent rappelé par les conciles
prouvant ainsi que l’interdit du mariage était peu respecté et que
les sanctions brandies comme l’excommunication étaient inefficaces.
En réalité, la législation conciliaire semble surtout vouloir
imposer la continence, en reprenant l’esprit de Grégoire le Grand
qui recommandait de vivre avec la mère ou la sœur, ou de prendre épouse
tout en restant chaste*.
-
- Le prêtre ne doit pas se livrer à des prêts ou à des activités
commerciales. Dans ce but, des revenus ont été octroyés au
desservant de la paroisse.
-
- 3. Les revenus du prêtre
-
- – Du salaire initial versé en nature par l’évêché, le prêtre
se voit attribué des revenus attachés à son église.
-
- – Il s’agit de rentes foncières provenant d’une parcelle de
terre. Ce revenu par sa stabilité permet au clerc de vivre sans trop
compter sur la générosité des fidèles.
-
- – Les offrandes des fidèles, au début volontaires, deviennent
peu à peu obligatoires et sont liées à la délivrance de tous les
sacrements.
- • Ainsi, l’achat par un fidèle d'une place au cimetière se généralise.
- • Ainsi, la dîme, versement du dixième des récoltes après leur
bénédiction, devient obligatoire en 765 en Gaule. Son produit est
traditionnellement réparti en trois parts, l’une revenant à l’évêque,
l’autre au prêtre, la dernière à la fabrique* (entretien des bâtiments,
des hostes, …).
-
- 4. Formation et discipline
ecclésiastique
-
- a) La formation
-
- La formation est rudimentaire, et de ce fait beaucoup de prêtres
sont ignorants. Au dire de saint Boniface, un prêtre bavarois
baptisait " in nomine patria et filia ", déformant
une formule qu’il ne comprenait pas (" au nom de la patrie
et de la fille ").
-
- Tous les conciles reconnaissent cette situation et tentent de
l’enrayer. Le concile de Narbonne en 589 demande que tous les prêtres
sachent lire. En 529, le concile de Vaison recommande aux clercs
d’avoir de jeunes lecteurs afin de préparer leur succession.
- C’est donc dans l’ignorance que le prêtre devra exercer ses
fonctions.
-
- b) Les fonctions
-
- – Par son mode de vie, le prêtre doit édifier* les hommes.
-
- – Il est l’homme de la charité, doit apporter secours et
assistance aux pauvres et aux faibles (la veuve, l’orphelin…), la
baisse de ses revenus ne le lui permettra pas toujours.
-
- Aux temps carolingiens, le prêtre devra tenir ouverte une école
rurale. L’enseignement dispensé sera rudimentaire.
-
- Il apporte la parole. Ses sermons, en langue vernaculaire, souvent
ennuyeux et peu fréquents, sont prononcés le dimanche lors de la
messe. Le dimanche est le jour du Seigneur (en Gaule, depuis le
concile d’Orléans en 538) et deviendra théoriquement un jour chômé
(en Gaule, sous les Carolingiens). Dans son prêche, le prêtre met
l’accent sur les problèmes moraux, le paiement de la dîme,
l’assistance à la messe.
-
- Il dispense les sacrements aux paroissiens.
-
- C. Les fidèles
-
- Médiocrité des sermons et cérémonies peu attrayantes ont pour
conséquence un manque d’enthousiasme et de compréhension des fidèles,
expliquant peut-être la survivance du paganisme ou l’attrait des
cultes des saints. L’exiguïté des édifices permet difficilement
à l’assistance d’être nombreuse à l’office qui devient
pourtant obligatoire (en Gaule depuis le IIIe concile d’Orléans
en 538).
-
- C’est à l’église que les fidèles reçoivent les différents
sacrements.
-
- 1. Les principaux
sacrements*
-
- a) Le baptême*
-
- Ce sacrement initial conserve une importance essentielle et le prêtre
doit veiller à ce qu’il soit conféré à tous. La cérémonie, au
départ réservée aux églises baptismales lors des fêtes de Pâques
et de Pentecôte, peut avoir lieu dans toutes les églises.
-
- Réservé aux adultes, le sacrement est peu à peu dispensé aux
jeunes enfants. Mais l’archaïsme du rituel, notamment la triple
immersion, a contribué à repousser l’âge du baptême.
-
- L’importance du parrain et de la marraine s’accroît : leur
rôle est de veiller à l’éducation chrétienne de leurs filleuls
et remplacer les parents naturels qui ont transmis à leurs enfants le
péché originel.
-
- b) La pénitence
-
- Culpabilité et pardon sont au centre de la vie chrétienne. Le haut
Moyen Âge a connu trois types de pénitence :
-
- – La pénitence publique, spectaculaire, est réservée aux cas
extrêmes d’homicide, d’adultère, d’idolâtrie. Mais sa
pratique régresse au profit de la pénitence tarifiée.
-
- – Les fautes sont confessées aux prêtres et pardonnées après
l’application de la pénitence que le prêtre tire d’un pénitentiel.
-
- – Les pénitentiels, livres trop fantaisistes, disparaîtront mais
l’habitude de la confession privée subsistera. Le prêtre impose
une pénitence sans prononcer le pardon mais en priant pour le pécheur.
-
- Dans tous les cas, il était possible d’acheter financièrement le
pardon.
-
- c) La communion
-
- La réception du sacrement était interdite à tous ceux qu’une
faute grave condamnait (adultères, meurtres…).
-
- La communion n’est pas pratiquée fréquemment. Le concile d’Agde
en 506 exige trois communions annuelles sous les deux espèces, à Noël,
Pâques et Pentecôte.
-
- d) La confirmation
-
- Ce sacrement lié à la visite épiscopale puisque administré par
l’évêque ne concerne qu’une élite.
-
- e) Le mariage
-
- Selon les coutumes barbares, le mariage est un contrat de type civil
entre deux familles.
-
- C’est en se portant garant de l’indissolubilité du lien consacré
et en veillant à ce qu’aucun mariage entre cousins ne soit pratiqué
que le clergé sacralise le mariage.
-
- f) Funérailles et sépultures
-
- Après la messe à laquelle ont droit tous les morts (sauf les
suicidés et les condamnés à mort), le fidèle est inhumé dans une
tombe du cimetière. Le corps est vêtu entouré d’un mobilier funéraire
réduit au minimum et n’est plus jamais en relation avec le
paganisme.
-
- 2. Les conséquences
sociales
-
- – L’organisation et la vie paroissiales ont eu pour conséquence
la naissance du sentiment d’appartenance à une communauté.
-
- • En effet, les fidèles ne peuvent en aucun cas recevoir les
sacrements ni participer à des prières en dehors de leur paroisse,
si bien que du berceau à la tombe ils sont assignés à une église,
à son prêtre.
-
- Du Ve au VIIIe siècle, s’opère un
transfert progressif : de l’Église affrontée aux Barbares qui
existait à la fin de l’Empire, s’est opéré le passage à des Églises
véritablement barbares, nées et grandies dans les royaumes qui se
succèdent alors en Occident ; celles-ci se structurent,
s’organisent plus ou moins rapidement, mais toutes selon une hiérarchie
dont la cellule de base, malgré certains particularismes, est la
paroisse, ferment d’unité religieuse et sociale.
-
|
- Eléments
bibliographiques
-
- M. Aubrun, La paroisse en
France des origines au XV° siècle,
- Paris, 1986.
M. Aubrun, Moines, paroisses et paysans, Clermont-Ferrand,
- 2000.
G. Duby, Les Trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme,
Paris,
- 1978.
|
tiré de : http://www.univ-tlse2.fr/multimedia/
medievale/UE5/ue5_med_cours/ue5_med_2l.htm#IB
|
